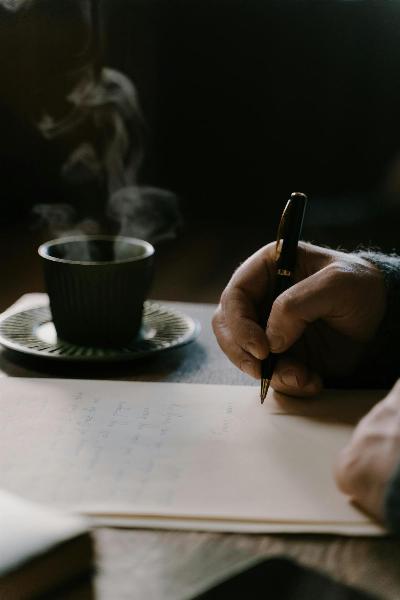Charybde et Scylla
Est-il possible de hasarder maintenant des prédictions sur l'avenir politique qui s'offre à l'humanité ? Il est donc probable, selon nous, que le régime démocratique actuel sera remplacé, après des péripéties plus ou moins difficiles et plus ou moins longues, par un régime fonctionnel, et qu’il se sera débarrassé de ce qui l'empêche maintenant de réaliser le bien commun. C'est-à-dire que, d'une manière qui échappe à toute description précise, la partie obscure des peuples ne sera plus admise à exercer sur la politique et sur la société en général l'influence directe et déterminante qui lui est maintenant réservée.
Je ne m'adresse qu'à ceux que l'existence du monde, incluant la leur propre, ne cesse d'émerveiller et de remplir d'une ferveur sacrée.
La seule existence d'un être quelconque est un miracle si prodigieux que sa contemplation pourrait occuper une vie entière. Mais la splendeur de l'univers, son ordre si parfait et si complexe qui peut néanmoins s'exprimer par quelques formules mathématiques simples, sa beauté infinie et la hauteur sublime où l'homme s'élève parfois par son intelligence, sa bonté et son amour doivent plonger tout homme sain dans un ravissement, dans une extase plus délicieuse que tous les plaisirs terrestres.
Cependant, l'être pour l'homme constitue d'abord un profond mystère que son intelligence apercevra toujours confusément pour l'essentiel, car l'extrême évidence de l'être cohabite dans son esprit avec l'impossibilité d'en saisir clairement l'origine, la cause et le sens. Et la science expérimentale, bien entendu, ne sera jamais que de peu d’utilité pour cet effet puisque ses méthodes mêmes la cantonnent dans l'observation des phénomènes matériels quantifiables, et qu'il serait vain de rechercher la cause de l'ensemble du monde par l'observation d'une de ses parties infimes. Sans compter que nos connaissances nous viennent en grande partie des sens, qui nous transmettent une image probablement déformée de la réalité, image qui n'existe d'ailleurs que dans notre esprit et non pas dans la réalité.
Ainsi le rouge que mon esprit perçoit est causé par l'action de la lumière d'une certaine fréquence sur mon œil; mais cette lumière en elle-même n'est pas rouge, pas plus que la surface qui la réfléchit et que je ne connais pas directement. Ce rouge n'a aucune existence dans le monde matériel : ce qui, soit dit en passant, prouve élégamment que l'esprit n'est pas réductible au matériel.
Mais si peu que l'on puisse soulever le voile du mystère qui nous empêche de comprendre clairement l'être, il faut le tenter et s'y appliquer de toutes nos forces. Pour ce faire, il faut d'abord faire confiance à notre esprit, à sa justesse, à sa capacité de connaître utilement, sanctionnée par le sentiment de l'évidence qu’il nous procure à l'occasion. Sinon, aucune lumière ne nous éclaire, l'évidence est une illusion, et l'intelligence prodigieuse dont l'humanité est douée, à tout le moins dans ses meilleurs éléments, ne mériterait aucune confiance, malgré les succès remarquables qu'elle a remportés dans tous les domaines.
Supposons donc qu'elle soit un guide assez sûr pour qu’on puisse s’y fier, en la contrôlant, bien entendu. Une des données essentielles de notre intelligence, c'est le principe de causalité, l'idée qu'un état de l'être s'explique et se comprend par un état « antérieur » de l'être. Antérieur dans l'ordre causal, et antérieur dans l'ordre temporel. Nous appliquons ce principe avec confiance dans le monde physique, à tout le moins à notre échelle, sans avoir été convaincus d'erreur, et il paraît donc naturel de l'appliquer globalement au monde lui-même, en postulant qu'il a, lui aussi, une cause qui l’explique et le fasse comprendre.
On pourrait d'abord penser, comme Spinoza, que l'être est sa propre cause, qu'il est Dieu, qu'il possède une infinité d'attributs parfaits, dont l'étendue, la pensée, et d'autres qui nous sont inconnus. Ou l'on peut suivre cette très longue et très vénérable tradition occidentale, qui affirme que le monde, malgré les perfections et les beautés qu'on y observe, est, aussi, frappé d’imperfection, à commencer par nous-mêmes, que les êtres qui le composent sont dans un flux perpétuel, par la désagrégation et la recomposition de leurs éléments, et que cette instabilité, cette imperfection, indiquent plutôt que le monde a été causé ou créé.
Cette cause ne nous est guère connue, sauf à dire que, pour bien expliquer l'univers, son immensité, sa splendeur, sa puissance et sa beauté, l'on doit supposer dans cette cause une puissance et une perfection sans limite imaginable. Cette perfection illimitée nous dispense d’ailleurs de poursuivre plus loin notre recherche, et nous permet de nous reposer dans la contemplation de cet Être non causé, parce qu’infini, illimité et parfait. Le nom de Dieu est généralement donné à cette cause depuis les penseurs grecs qui, les premiers, ont recherché Dieu par le seul effort de la raison, et montré qu’il pouvait être connu déjà par cette voie, indépendamment de toute foi religieuse.
Dans cette conception, que nous privilégions, Dieu, infiniment plus parfait que sa création, jouit d'une intelligence complète de tout l'être, d'une volonté toute puissante, et le monde, produit de cette volonté et de cette intelligence, résulte de desseins insondables, que seuls les grands mystiques pensent avoir entrevus parfois dans une fulguration et une extase indicibles. Bien qu'il soit aventureux de dire l'indicible, ce qu'on peut retenir de leur contemplation relève du mot «amour», d'un amour à côté duquel nos pauvres amours sont aussi petits et infirmes que nos plus belles créations comparées à la splendeur de Son œuvre.
Et nous qui marchons depuis si longtemps à tâtons dans l'univers incompréhensible où nous avons été jetés, pour notre bonheur et pour notre malheur, le terme de la connaissance de notre étrange destin que les meilleurs d’entre nous ont pu acquérir, c'est que nous y sommes placés, avec nos perfections et nos imperfections, par l'effet d'une cause d'une inimaginable puissance, dans un but obscur, souvent inquiétant, illuminé cependant pour de rares privilégiés par la fulguration intermittente d'un immense amour, qui se révèle assez rarement pour que la plupart des hommes l'ignorent, mais assez clairement aussi pour que plusieurs en aient une certitude absolue.
C'est dans cette pénombre, dans cet assemblage étrange de clair et d’obscur, que s'est déroulée la marche douloureuse et triomphante de l'humanité, animée tout juste d'assez d'espérance pour poursuivre sa quête et d'assez d'intelligence pour en deviner confusément la direction.
Chapitre 2
La connaissance et la science
L'empire incontesté qu’exerce la science sur l'humanité et le prestige presque exclusif qu'elle voudrait posséder reposent selon nous sur un malentendu qui doit être dissipé.
La science se définit par sa méthode, qui consiste dans l'observation humble et patiente des phénomènes matériels, mesurables et répétables, jusqu'à ce que des régularités d'abord, puis des lois s'en dégagent.
Ces lois ont toujours un statut essentiellement hypothétique et précaire, bien que le temps finisse par leur conférer une grande valeur, lorsque aucune observation, aucune expérience ne les infirment. Elles n'ont d'ailleurs de validité que si les observations ou les expériences qui les fondent sont incontestables, idéalement parce qu'elles sont vérifiables par une simple répétition.
Les résultats extraordinaires obtenus depuis quelques siècles par cette méthode en démontrent l’incomparable fécondité, certes, et les progrès matériels réalisés grâce à elle lui ont mérité une popularité et un respect considérables. Mais l'énorme valeur pratique de la science ne doit pas nous aveugler sur le fait qu'elle est condamnée par sa méthode même à n'appréhender du réel qu'un fragment très utile pour dominer la nature et en saisir le fonctionnement concret, mais qui ne nous renseigne pas, et ne peut nous renseigner, sur les vérités qu’il nous importerait le plus de connaître et qui portent sur la cause, le sens, la finalité de l'être, l'usage que nous devons faire de notre liberté.
Toutes ces questions, qui ne relèvent pas de l'observation des phénomènes matériels mesurables, dépassent totalement et dépasseront toujours ses capacités. Et il n'y aurait d'ailleurs évidemment pas grand mal à cela, puisqu'il est parfaitement normal que tout mode de connaissance ne nous renseigne que sur les objets qui sont proportionnés à ses méthodes. Mais le malheur, c'est que la science, par le discours de plusieurs de ses pontifes enivrés de ses succès, bien que dans un ordre très modeste, aspirent pour elle à un empire très étendu, en cherchant à éclaircir par ses méthodes les questions fondamentales qu’il importe vraiment à l'homme de résoudre.
Et les bienfaits dont la science a apparemment comblé l'humanité, la relative certitude de ses résultats fondamentaux ont fait regarder favorablement cette prétention par un grand nombre. C'est là une méprise regrettable, et aucun raisonnement n'est plus faux que celui qui rejette toute forme de connaissance qui n'est pas réductible à la méthode scientifique. Et l'idée, par exemple, qu'il faudrait conclure à l'inexistence de Dieu, ou de l'esprit, ou de toute autre réalité, parce qu'on n'en voit pas de preuve scientifique, est l'une des plus sottes qui puisse se former dans l'esprit humain.
Ses conséquences sont malheureuses, parce que l'objet de la science étant le monde matériel, ceux qui la pratiquent tendent à réduire le réel au matériel, envisagé comme une mécanique, ce qui favorise une représentation très pauvre de l'infinie complexité de l'être.
Donnons un exemple de ce dont il s'agit pour clarifier notre pensée. La présence de la vie sur terre, en nous et hors de nous, avec son inimaginable complexité et sa stupéfiante beauté, a toujours paru justifier l’évidence qu'un tel miracle ne pouvait être le fruit du hasard, et qu'il supposait un créateur intelligent qui a voulu et procuré ce résultat. Ceux que la pensée d'un être transcendant chagrine, et qui préfèrent l'idée d'un univers purement matériel, où aucun être supérieur ne vient entraver leur liberté ou diminuer leur prestige, prêchent que l'argument tiré de la complexité et de la splendeur des êtres vivants n'est pas valide, puisque la vie s'explique parfaitement, sans l'intervention d'aucune cause transcendante, par le banal mécanisme de l'évolution guidée par la sélection naturelle du plus apte à la survie.
Cependant, il est aisé de voir que cette explication simpliste n'a aucune valeur intellectuelle, pour un grand nombre de raisons.
D'abord, surtout maintenant qu'elle nous est mieux connue, la structure de l'univers physique nous emplit d'autant d'admiration et d'étonnement que la vie elle-même. Et pourtant, l'évolution n'explique en rien la complexité, la beauté, l'harmonie, la grandeur de l'univers matériel inanimé.
Ensuite, la vie n'a pu commencer et se développer jusqu'au degré de complexité où elle est parvenue que parce que l'univers inanimé la contenait en puissance, parce que sa composition et ses structures permettaient les phénomènes physiques et chimiques qui ont permis l'apparition et l'évolution de la vie. Mais qui ne voit aussitôt que le même argument finaliste, que nous tirons de la vie elle-même, peut être tiré de cet univers miraculeux, ainsi constitué qu'il contenait en puissance la vie telle que nous la connaissons. Et, encore une fois, l'explication par la sélection naturelle ne peut être évoquée à propos de l'état du monde avant l'apparition de la vie et rendre compte d’un monde doté de pareilles potentialités.
Également, parlant spécifiquement de l'être humain, l'idée qu'un mécanisme aussi lent que la sélection naturelle puisse expliquer, par la simple survie du plus apte et de rares mutations, l’apparition aléatoire de la quantité immense de systèmes incroyablement complexes qui nous composent, dans la période très limitée qui nous sépare de l'origine de la vie, relève d'une invraisemblable naïveté. Cette période ne peut raisonnablement aboutir, par hasard, à la formation de l'œil, du cerveau, de la pensée, de la reproduction, de la digestion, de la respiration et de tant d'autres systèmes dont la vie animale et végétale nous donnent le spectacle étonnant.
Pour passer du néant à nous, les organismes ont dû franchir des millions ou des milliards d'étapes par l'effet d'un mécanisme évolutif qui porte pour les animaux supérieurs sur une très longue durée, de l'ordre des millénaires et bien davantage. La durée disponible à l'action de l'évolution est clairement insuffisante, à supposer évidemment, contre toute vraisemblance, qu'une période de temps quelconque puisse expliquer notre apparition par ce mécanisme aveugle.
Enfin, l'évolution n'explique que les traits qui favorisent la survie de l'individu. Elle n'explique donc pas ceux qui sont indifférents à cette survie, encore moins ceux qui lui sont contraires. Pourquoi la beauté des fleurs, de tant d'autres formes vivantes dont les coloris, la texture, le galbe nous ravissent d'admiration ? Pourquoi les êtres vivants sont-ils programmés pour mourir ? En quoi cela les rend-il aptes à survivre ?
Sans oublier, pour conclure, le problème de la conscience pour laquelle la science n'a aucune explication matérialiste sérieuse et dont en particulier l'évolution d'organismes purement matériels ne peut aucunement rendre compte.
Non seulement la science par nature est-elle un mauvais guide dès que l'on agite des questions fondamentales, ce qui serait sans importance, mais elle cause un tort immense par l'esprit sectaire et souvent même fanatique de très nombreux scientifiques qui ne reconnaissent aucune valeur à toute connaissance que ne peuvent produire les ressources extrêmement limitées de l'étroite méthode suivie par la science expérimentale. A cause d'eux, la représentation que l'homme se fait du monde et de lui-même est plus pauvre, moins enrichissante et moins éclairante qu'elle ne pourrait l'être autrement.
Chapitre 3
L’homme
Le monde, tel qu'il nous apparaît du moins, ne compte qu’un seul être imparfait, et c'est l'homme lui-même.
L'univers matériel obéit avec une parfaite régularité aux lois qui le régissent, au niveau du moins où s'effectuent les observations de l'homme. Les animaux sauvages suivent leur instinct et les plantes leur nature qui en assure la conservation et la reproduction sans donner aucune prise au jugement moral.
L'homme seul possède le privilège de choisir, d'agir bien ou mal, de céder à l'attrait de sollicitations momentanément plaisantes bien que reconnues trompeuses ou défendues. De tous les objets de notre connaissance, le plus mystérieux c'est sans doute nous-mêmes.
C'est ici en particulier que la méthode scientifique se révèle totalement inadéquate et ne peut satisfaire cette curiosité insatiable qui nous pousse à chercher ardemment le secret de notre origine, de notre nature et de notre fin. Et cette connaissance incertaine, fragmentaire, doit être recueillie patiemment par chaque homme en méditant inlassablement sur les données que lui fournissent son expérience, ses intuitions et la lecture des grands textes qui illuminent la longue marche de l'humanité par des fulgurations exceptionnelles, qu'elles soient d'ordre philosophique, religieux ou même mystique. Et parmi ces illuminations, je retiens tout particulièrement celles qu'on peut tirer du récit de la création de l'homme dans la Genèse.
Selon ce mythe, peut-être le plus connu de tous les mythes, l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu est déchu de la félicité et de la perfection qui lui avait été réservées pour avoir mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Évidemment, l'homme rationnel est appelé à vivre une vie morale par ses plus profonds instincts, ce qui suppose qu'il doit être capable de découvrir ce qui est bien ou mal et d'en acquérir la connaissance. La faute ne peut donc pas être dans cet effort vers la connaissance du bien et du mal, mais plutôt dans le fait de s'y ériger juge souverain de ce qui est bien ou mal, indépendamment de toute recherche objective de ce qui s'impose comme moralement valable. Et c’est pourquoi la connaissance du bien est assimilée dans le récit biblique à un fruit qui charme les sens.
Autrement dit, la faute consiste à remplacer la recherche humble et patiente du bien moral fondée sur la contemplation de la nature du monde et de l'homme et sur leurs finalités, par une morale purement subjective, l'expression des désirs, des intérêts, des passions de chaque homme. C'est cette prétention à fonder en soi seul le jugement moral en toute indépendance que le texte de la Genèse condamne comme un délire d'orgueil par lequel l'homme veut s'égaler à Dieu en prétendant souverainement connaître les lois d'un monde et d'une nature, la sienne propre, qu'il n'a pas créés. Et la source féconde du malheur de l'homme est là, dans cette prétention démesurée à poser les règles de sa vie en consultant ses délires, ses ambitions, ses intérêts supposés, sans égard à la réalité et à ses lois objectives.
Et le malheur, c'est que le nombre de ceux qu’anime le désir profond et tenace d'approfondir sans cesse leur compréhension du monde et de toutes ses réalités est fort restreint, de sorte que la faute d'Adam est celle de l'immense majorité des humains dont l'intelligence est subordonnée à la survie et produit des notions, des raisons et même des raisonnements qui n'ont d'autre origine que le désir de justifier et de soutenir leurs appétits, leurs intérêts et la conception instinctive qu'ils se font de leur bien. Et le malheur se compose et s'augmente du fait que, peut-être inévitablement, la pensée du grand nombre est produite collectivement par imitation, répétition et émulation. Cette caractéristique, utile certes à l'éclosion d'une pensée capable de rallier ou d'inspirer à une action collective un peuple donné pendant une certaine période de son histoire, rend encore plus difficile la formation d'une pensée rationnelle, réfléchie, objective. Ces épithètes, si l'on y pense bien, décrivent assez mal l'excitation, la précipitation, l'irréflexion et l'outrance des phénomènes collectifs.
Chapitre 4
L’exemple du féminisme
Illustrons nos propos par quelques réflexions sur une idéologie qui a connu le plus grand succès depuis cent ans, le féminisme, et tâchons de montrer la part d'irrationalité et de fausseté qu'elle contient.
Je précise cependant que je ne soutiens pas la thèse que le féminisme comporterait plus d'irrationalité ou de fausseté que d'autres idéologies, car je crois au contraire que les conditions dans lesquelles s'élaborent toutes les formes de pensée collective les condamnent à l'erreur et à une égale irrationalité.
La première chose qui résulte de l’application concrète du féminisme, c'est une réduction considérable du taux de natalité des sociétés qui l'adoptent, bien en deçà des taux qui permettent la croissance ou même le maintien de la population en cause. Il en résulte, inexorablement, que pour éviter une décroissance accélérée de cette population, qui mène à la stagnation économique, conduit à imposer aux jeunes la charge d'entretenir une fraction toujours croissante de la population vieillissante, et qui ultimement produira l'extinction du peuple en cause, il devient indispensable d'admettre un flot considérable d'immigrés qui ne pourront provenir des sociétés qui partagent nos valeurs et notre culture, puisqu'elles ont aussi désespérément besoin d'attirer des immigrants, et pour les mêmes raisons que nous.
Ces flots migratoires devront donc nécessairement provenir de sociétés non-féministes, possédant un taux de natalité élevé, ce qui en pratique signifiera le plus souvent les sociétés issues de l'Islam ou de l'Afrique noire. Il pourrait donc bien arriver que le féminisme mène insensiblement à l'afflux croissant de populations non-féministes, au taux de natalité fort élevé, qui finiront par dominer la société, ou du moins y exercer assez d'influence pour combattre avec plus ou moins de succès le féminisme lui-même.
En somme, il était évident au départ que le féminisme risquait de se détruire lui-même à la longue, par la sévère dénatalité qui en résultait. Ce grave problème a-t-il reçu la moindre attention ? A-t-il suscité la moindre discussion ? Est-il même permis de le poser clairement ? Non, dans tous les cas, parce que le féminisme n'est pas une pensée, mais une construction collective où l'intelligence prend beaucoup moins de part que le désir ou l'intérêt.
De la même façon, si le féminisme relevait de la pensée et de la raison, il aurait consacré tous les efforts nécessaires pour élucider en toute sérénité et en toute objectivité les nombreux problèmes qu'il pose par essence. Par exemple, où sont les discussions objectives et sérieuses sur les conséquences de la dislocation complète de la famille, qui en était une conséquence naturelle et prévisible. Quel effet la disparition des familles stables a-t-elle sur les enfants ? Est-il vrai que les hommes et les femmes ont à peu près les mêmes aptitudes et peuvent embrasser avec un même succès et un même bonheur les mêmes carrières ? Dit autrement, les femmes trouvent-elles le même épanouissement que les hommes dans les carrières traditionnellement réservées à ceux-ci?
Ou encore, risquent-elles de les transformer profondément par leur manière différente de les exercer ? Et cette transformation est-elle avantageuse dans tous les cas?
On peut aussi se demander ce que deviendra dans ce bouleversement l'amour profond, total, entre l'homme et la femme, joyau infiniment précieux, source des plus grandes joies et meilleure chance de bonheur pour d'innombrables êtres humains. Il était inévitable que cet amour périclite entre l’homme et la femme devenus compétiteurs, parfois féroces, engagés dans un même mode de vie épuisant, et privés de cette harmonieuse complémentarité qui les rapprochait infiniment en les éloignant infiniment.
Sans compter la question fondamentale qui gît à la racine du féminisme et qui nous interpelle avec une inévitable brutalité :
Est-il possible que la femme ait été condamnée à réaliser parfaitement sa féminité en singeant avec plus ou moins de succès la masculinité?
Encore une fois, non seulement toutes ces questions ne reçoivent-elles aucune attention sérieuse, mais même une sorte d'anathème frappe tous ceux qui seraient assez intempestifs pour tenter de les soulever.
Prenons un seul exemple, celui de l'égalité des aptitudes entre les deux sexes, et surtout des aptitudes intellectuelles, plus difficiles à mesurer que la force physique, où la femme se console aisément de son infériorité, vu que depuis fort longtemps, ce n'est plus par son moyen qu'on va à la richesse, au pouvoir, aux honneurs.
Cette égalité ne peut sans crime être mise en doute, et pourtant, il crève les yeux qu'elle tient de la fantaisie et du mythe. Précisons que nous parlons surtout ici des meilleurs éléments des deux sexes, des individus les plus doués, les plus créateurs. Ceci dit, il est incontestable que dans le domaine de l'intelligence abstraite, les hommes sont la cause IMMÉDIATE (il faudra revenir sur ce point essentiel) de la quasi-totalité des découvertes de l'humanité depuis l'origine. La philosophie, les mathématiques, la physique théorique et les autres sciences fondamentales, l’informatique, les progrès de l'intelligence artificielle sont leur ouvrage.
Même dans le domaine plus humble des jeux abstraits, comme le sont les échecs sous toutes leurs formes ou le go, les femmes ne compétitionnent pas plus avec les hommes que dans les sports physiques.
Et l'on ne peut plus soutenir que cette disparité résulte des restrictions sociales qui empêchent l'épanouissement des femmes, puisque ces restrictions sont abolies depuis plusieurs générations.
En réalité, il n'y a que les domaines où l'État exerce une influence déterminante qui paraissent échapper à cette règle. Mais cette apparente égalité résulte du parti pris avoué de l'État d'avantager les femmes en leur garantissant un accès égal à tous les avantages qu’il peut conférer : nominations, récompenses, honneurs, subventions, crédits, etc.
Sitôt cependant que le départage des concurrents repose sur une base objective comme la victoire aux échecs ou la découverte de théorèmes difficiles, l'homme reprend tranquillement son avantage.
Je ne crains pas de dire que tout ceci est tellement évident qu'un jour nos descendants seront incapables de comprendre comment nous avons pu tomber dans cet excès de stupidité qui nous a empêché non seulement de le voir mais même de nous poser la question et d'accepter qu'on en discute. Il est inévitable cependant que ces mêmes descendants souffrent à leur tour de cécités partielles différentes mais d'une égale gravité, dont par aucun effort de leur volonté ils ne pourront se rendre conscients.
Chapitre 5
La démocratie
Aucune idée n'a si profondément modelé notre époque que l'idée démocratique, que nous devons maintenant essayer de mieux comprendre. La démocratie s'articule autour de deux pôles contradictoires. L'égalité d'une part, la liberté de l'autre.
Ils sont contradictoires parce que pour faire régner l'égalité entre des individus radicalement inégaux, l'État devra user d'une contrainte destructrice de la liberté. Si d'autre part, il protège la liberté et laisse ses sujets régler librement leurs affaires entre eux, les inégalités les plus choquantes en résulteront aussitôt.
Les démocraties naissantes ont avant tout cherché à créer les conditions de la liberté, plus faciles à établir parce qu'elles résultent de la passivité de l'État, toujours aisée à pratiquer. La seule forme d'égalité qui s'impose à l'origine, parce qu'elle touche à l'essence du régime, c'est l'égalité politique qui se réalise par la participation égale à l'élection des gouvernants. Non pas que les démocraties commencent par le suffrage universel, ils s'en faut de beaucoup, puisque dans leurs commencements, une grande majorité de la population est généralement exclue du vote.
Les fondateurs de la démocratie américaine, par exemple, auraient été horrifiés à l'idée qu'un jour les esclaves et les pauvres voteraient. Ils auraient même regardé avec suspicion la possiblité d’intéresser leurs femmes, qu’ils aimaient pourtant tendrement, à la chose publique. Sans doute auraient-ils préféré demeurer dans le giron de la monarchie britannique que de tomber un jour au pouvoir de cette multitude effrayante. Car la croyance constante de tous les penseurs du passé, c'est que l'immense majorité des hommes est incapable non seulement de participer directement au gouvernement de l'État, mais même d'exercer une influence bénéfique sur aucun aspect de la vie en société.
Cette pensée, par prudence, ne s'est pas toujours clairement exprimée, mais il est toujours aisé d'en percevoir la trace tout au long de l'histoire. Ce constat traditionnel repose sur un trait fondamental de la réflexion politique et morale de l'Occident, je veux dire un pessimisme radical sur les capacités intellectuelles et morales de la plupart des hommes. Et ce que les fondateurs de républiques envisageaient finalement comme égalité, se limitait à permettre à une partie de la population de se donner librement un gouvernement, en choisissant parmi plusieurs candidats, tous issus de l'élite politique de la société, et tous d'accord sur l'essentiel des valeurs et des attitudes qui assuraient la pérennité et la prospérité de cette société.
Et ce code d'honneur comportait comme pierre angulaire que les candidats au pouvoir politique allaient déterminer les éléments fondamentaux de leur programme d'action en leur âme et conscience, et sans céder à la tentation facile de déférer aux caprices populaires ou de flagorner leurs électeurs en se réglant entièrement sur leurs désirs, si déraisonnables soient-ils.
Cependant, les démocraties occidentales modernes ont été établies juste après la publication des écrits de l'un des écrivains les plus influents et les plus désaxés de l'histoire, Jean-Jacques Rousseau. Il a voulu en effet lever la condamnation qui pesait sur l'homme depuis l'origine de la pensée occidentale et dissiper le pessimisme radical qui en découlait, en réhabilitant pleinement l’homme, en proclamant que le spectacle tragique de ses erreurs et de ses folies avait jusqu'à lui été mal interprété, puisqu'en vérité ces défaillances bien réelles du caractère et des actions de l'homme ne résultaient pas de sa nature, qui était excellente, mais de la corruption de cette nature par l'action délétère de la société, seule responsable de la folie et des crimes de l'humanité.
Autrement dit, et pour la première fois, l'homme était invité à se disculper de ses fautes pour accéder à un statut supérieur en évoquant sa condition de victime : technique promise, comme on le sait, à un si brillant avenir.
Cette croyance insuffle une nouvelle vigueur au concept de l'égalité, puisque les inégalités observées ne sont plus que les différents degrés de corruption, par la société, d'individus à l'origine excellents et non responsables de leurs nombreux manquements.
Il faut dire aussi que dans le conflit déjà signalé entre la liberté et l'égalité, cette dernière, peu développée à l'origine, possède néanmoins un précieux avantage, puisque c'est elle qui constitue la marque essentielle de la démocratie. La liberté, en effet, peut se retrouver dans tous les régimes, et l'on pourrait même théoriquement concevoir une démocratie d’où elle serait absente, si tel était le voeu de la volonté générale.
Il était donc tout naturel que le ferment d'égalité que contenaient les démocraties occidentales à l'origine, et qui en constituait, à l’insu peut-être de ses fondateurs, le principe actif essentiel, développe ses potentialités toujours davantage au fil du temps, sous réserve peut-être de quelques épisodes historiques anormaux, comme le fascisme ou le nazisme, qui, malgré leur origine purement démocratique, dérogent temporairement au développement de l'idée d'égalité.
Il en est ainsi parce que toute société est fondée sur un équilibre conforme à ses principes fondateurs. Mais cet équilibre ne peut être statique, attendu qu'un groupe humain, comme tout être vivant, est dans un flux et un mouvement perpétuels, qui lui interdisent de demeurer identique à lui-même dans le temps. De sorte qu'il arrive que, pour conserver son identité, ce groupe doit rester fidèle à son principe, et que, pour évoluer, il n'a d'autre choix que de donner toujours plus d'extension à ce même principe. Malheureusement, cette extension ne peut croître indéfiniment sans tomber dans l'abus, dans l'excès, et sans compromettre fatalement, un jour, la survie du régime.
Et c'est exactement le chemin qu'ont parcouru, avec des nuances de détail, les démocraties occidentales. L'idée d'égalité, si restreinte à l'origine, n'a cessé de s'étendre pour englober les femmes, les hommes de toutes les races, les pauvres, toutes les personnes revendiquant avec succès le statut de victime historique à cause de n'importe quelle caractéristique personnelle, si ténue soit-elle. Ce statut, qui atteste d'une inégalité passée, ouvre le droit à la cessation immédiate de cette inégalité et, surtout, à des réparations fort intéressantes qui prennent toutes les formes imaginables, depuis l'argent jusqu'à une préférence avouée dans l'accès aux charges et aux honneurs dispensés par l'État, sans égard au mérite réel.
Une autre extension déplorable de la notion d'égalité concerne l'égalité politique. La conception de départ, suivant laquelle la majorité ne possédait pas les qualités intellectuelles et morales pour déterminer directement la politique appropriée à la conjoncture, mais pouvait choisir valablement entre les propositions rivales des divers partis, dirigés par l'élite de la société, a été abandonnée. En effet, les majorités actuelles, même et surtout quand elles se composent largement ou presque exclusivement des éléments les moins intelligents et les moins éduqués d'une société, s'attendent à ce que leurs chefs exécutent aveuglément les idées saugrenues ou dangereuses que leur pensée fruste et incompétente a engendrées. Bien entendu, cette évolution eut comme corollaire l'apparition d'une classe de démagogues sans honneur et sans scrupule, prêts à offrir à ces multitudes égarées les mirages ridicules de grandeur et de prospérité qui leur assurent le pouvoir, le seul objet de leur désir. L'une des conséquences les plus funestes de l'extension excessive de la notion d'égalité, c'est l'opprobre et l'infamie qui s'attachent à tout discours qui remet ce dogme en question, notamment en rappelant que la seule égalité possible entre des êtres humains est l'égalité de droit, qui porte sur la dignité et la valeur de ceux-ci, et non pas l'égalité de fait, qui porte sur les différentes aptitudes de l'âme et du corps, lesquelles varient à l'infini selon l'individu, le sexe, la race, l'origine sociale, la génétique, l'éducation, etc.
Toute remise en question de l'égalité de fait au détriment des groupes de prétendues victimes d'inégalités historiques est punie de mort sociale, empêchant par là tout examen un tant soit peu rationnel de la vérité de cet égalitarisme outrancier.
Et une conséquence de cette conséquence, c'est que le groupe humain à qui l'humanité doit IMMÉDIATEMENT (j’ai dit qu’il faudra revenir sur ce point essentiel) la presque totalité de son progrès et de ses richesses culturelles et matérielles, les hommes occidentaux et en particulier l’élite de ceux-ci, tendent à être regardé avec méfiance, si ce n'est même diabolisés. Ce point, atteint et même dépassé depuis un certain temps dans les démocraties avancées, établit clairement une perte de contact collective avec la réalité, une folie générale qui annonce la mort imminente de la société affectée. J'en donne un seul exemple, parmi des milliers d'autres possibles, mais je crois qu'il est important de le méditer. L'un des innombrables effets pervers d'un féminisme affolé, c'est l'obsession presque exclusive de plusieurs avec le problème des agressions sexuelles, même sans gravité. Pour ces gens, l'État devrait mettre cette question au sommet de sa liste de priorité, comme s'il n'y avait pas mille problèmes plus importants et plus urgents que celui-là, surtout que les tribunaux existent depuis longtemps pour en fournir une solution acceptable. Mais comme plusieurs accusés avaient été acquittés en raison du fait que la plaignante leur avait exprimé sa satisfaction ou son affection ou sa bienveillance après la prétendue agression, et comme tout acquittement en cette matière est scandaleux, certains législateurs ont adopté des lois susceptibles d’être interprétées comme interdisant de tirer des inférences défavorables à la plaignante à partir de ces marques postérieures d'affection ou d'appréciation, au motif que ces inférences perpétueraient des stéréotypes répréhensibles. Il serait absolument incroyable de voir qualifier de stéréotypes blâmables le simple fait que la femme est un être rationnel et que l'on peut croire qu'elle aime ou qu'elle apprécie quand elle le dit, qu'elle l'écrit ou qu’elle agit de manière à le laisser supposer. Il est absolument évident qu'une société qui serait prête à donner valeur législative à une aussi injuste stupidité mériterait la mort prochaine qui l'attendrait certainement.
Chapitre 6
La crise actuelle
L'emprise qu’exerçait sur la société l'idéologie égalitaire, qui dans son long développement avait incorporé le féminisme et tous les mouvements recherchant la réhabilitation des victimes d'inégalités historiques était si forte, elle semblait si incontestable, et l'énorme pression psychologique et sociale qu'elle faisait peser sur ses opposants semblait si prépondérante, qu'il était devenu difficile d'imaginer que le mouvement n'irait pas sans cesse de l’avant, en développant sans fin de nouvelles conséquences qui nous plongeraient inévitablement dans toujours davantage de mensonge, de faiblesse, de bêtise et d’insignifiance.
Ce que nous avons appelé l'équilibre dynamique des démocraties occidentales, fondé sur l'accroissement indéfini des potentialités du concept d'égalité, était parvenu à un point critique où l'ordre social n'était plus que le reflet sans valeur et sans vérité des pensées et des aspirations de l'homme vulgaire, de celui qui se nourrit joyeusement des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et qui remplace la recherche difficile de la vérité et l'exercice pénible de la raison par l'affirmation péremptoire de la valeur de ses désirs, de ses intérêts et de ses préjugés. Et les peuples firent l'apprentissage de la tyrannie la plus déprimante, celle de la bêtise, contre laquelle, selon le poète Schiller, les dieux eux-mêmes luttent en vain.
Pourquoi l'inférieur ne commanderait-il pas, puisqu'il est l'égal du supérieur ?
Nous avons vu cependant, non sans surprise, cette construction artificielle, irrationnelle et fausse, s’effondrer subitement sous nos yeux dans un fracas retentissant.
Les événements qui transforment le monde et les États-Unis, et qui ont culminé par l'élection du dernier président, ont opéré un changement radical dans les préoccupations et la mentalité de nos sociétés, qu'il nous faut maintenant examiner.
Observons d'abord que l'accès au pouvoir de cet homme n'a été rendu possible que par la désertion massive des élites politiques traditionnelles, rebutées sans doute par la dégradation constante des conditions d'exercice de la profession politique, de plus en plus marquée par la bêtise, la bassesse, la grossièreté et l'abaissement du niveau moral et intellectuel du débat politique, qui est maintenant devenu celui de l'homme moyen, ou de quelque chose de pire encore.
La meilleure preuve en est que le peuple le plus puissant de la planète, d'une population de 350 millions d'individus, n'a pu mettre en lice pour la direction suprême de l'État qu'un sous-homme totalement méprisable, et une femme bien intentionnée peut-être, mais à peu près dénuée de compétence, d'expérience et même d'intelligence.
Peut-être que le mouvement égalitaire américain a péri par l'effet de ses propres principes, en croyant bêtement qu'une candidate qui réunissait les qualités de femme et de noire ne pouvait manquer d'emporter la victoire.
Disons ensuite qu'il peut sembler, à première vue, que la victoire de l'actuel président emporte la fin d'une idéologie égalitaire et victimaire fausse et débilitante, et qu'elle annonce une réaction aussi salutaire qu'inattendue contre cette forme dégénérée du principe d'égalité qui inspirait le parti politique adverse.
Ce serait une grave erreur et il est essentiel de constater et de dire hautement que la victoire de l'actuel président, dont les discours sont tout sauf égalitaires, est néanmoins due précisément à la même dérive de l'esprit démocratique, puisque l'adhésion d'une majorité d'électeurs à un personnage aussi répugnant à tous égards et à une doctrine aussi stupide ne peut être le fait que d'un groupe dénué à la fois du pouvoir de penser par lui-même et de l'humilité et du bon sens de se contenter d'arbitrer entre deux candidats valables et dignes, qui exposent honnêtement et rationnellement leurs conceptions personnelles du bien public.
En fait, nos démocraties ne peuvent plus corriger leur vice par l'heureux succès d'un scrutin, puisque maintenant le succès de ce scrutin est par définition le fait d'un groupe incapable de penser rationnellement par lui-même ni de choisir entre ceux qui le peuvent.
C'est pourquoi tous ceux qui à bon droit souffraient des effets délétères de l'égalitarisme excessif qui ravageait la société ne doivent aucunement se réjouir du triomphe de la droite américaine qui a mis un terme à ces abus. Il est impératif qu'ils réalisent au plus tôt qu'il s'agit simplement d'un changement d'erreur, que les folies nouvelles sont aussi destructrices que les anciennes, sinon davantage, et qu'une pensée informe, irréaliste et sans noblesse, comme le sera toujours la pensée collective de l'homme déchu, ne peut mener qu'à l'échec, quelles que soient les formes opposées qu'elle pourra revêtir.
Un examen sommaire des grands traits de cette doctrine et de ceux qui la soutiennent nous aura vite convaincus de sa complète nullité.
D'abord, elle est exposée et défendue par de vrais barbares, ce qui sans plus la déconsidère.
Le président, ses ministres et ses acolytes forment une bande de demi-civilisés, sans culture, sans humanité, sans raffinement, sans intelligence véritable et profonde. En un mot, ce sont des nains intellectuels et moraux.
Ensuite, leur univers mental primitif tourne autour des concepts grossiers de pouvoir, de force, d'argent, de finance, d'armée, de technologie, de production, de taxe, d'économie. Ce sont probablement les êtres humains les plus nuls et les moins bien réussis qui aient jamais occupé l'attention du public depuis l'origine.
Et leur terrifiante bêtise va probablement jusqu'à croire que le secret du bonheur pour l'homme réside dans l'argent corrupteur, le pouvoir destructeur et une technologie délirante affranchie de toute morale et de toute réflexion. En un mot comme en cent, ce sont tous de purs minables. Ils sont l'incarnation contemporaine de ce vil Calliclès qui, dans le Gorgias de Platon, embrasse la thèse que la justice, au fond, n’est autre chose que la force.
Et je crois fermement que leur bassesse foncière s’explique essentiellement par leur radicale séparation de toute influence féminine véritable et profonde. Je disais tout à l’heure que l’homme, grâce à ses dons intellectuels remarquables, est la cause IMMÉDIATE de la plupart des manifestations de la merveilleuse faculté de connaître impartie à l’humanité par Dieu. Mais l’exercice de ces mêmes facultés intellectuelles peut aussi bien le faire tomber dans la folie délirante des mégalomanes actuels, ivres de technique et de puissance et foncièrement nuisibles aux sociétés qui les hébergent, que l’élever aux plus sublimes vérités sur ses fins dernières ou sur le Beau.
Et l’influence qu’exerce la femme dans la société sera déterminante à cet égard. C’est elle qui par ses vertus spécifiques et ses dons essentiels élèvera ou abaissera le regard de l’homme, et donnera plus ou moins de hauteur et de valeur à sa pensée. Et ce n’est pas un hasard si la dégradation du climat politique et intellectuel est la plus grande aux États-Unis, cette société profondément inférieure sur le plan moral, frappée dès sa naissance d’un vice radical, la « Auri sacra fames », cette soif maudite de l’or, cette avidité de possessions matérielles et de puissance, qui est l’héritage empoisonné légué au monde par l’esprit anglo-saxon, incarné tout particulièrement dans la mentalité américaine, où même la religion devient pour plusieurs une entreprise commerciale sans dogme, sans traditions et sans beauté.
C’est là, plus que partout ailleurs, que les femmes achèvent de perdre jusqu’à la dernière trace de ces dons et de ces traits merveilleux qui en faisaient, à tellement d’égards, les guides, les inspiratrices et les éducatrices indispensables de l’homme, qui sans elles ne peut plus jouer que le rôle d’une brute sans grâce et sans finesse.
Cela dit, il est absolument essentiel de réaliser que les propos et les actions de ces hommes, si révoltants et si horribles qu'ils soient, n'ont qu'une importance très secondaire et ne devraient pas nous occuper outre mesure. Après tout, leur existence prouve seulement que l'espèce humaine comporte des tarés sans honneur, ce qui n'est pas bien nouveau. La seule question intéressante que pose leur existence n'est pas de savoir pourquoi ils sont, mais pourquoi ils ont été choisis avec enthousiasme et conviction par une importante majorité d'électeurs. C'est sur ce point seulement que devront se porter toutes nos réflexions, parce que c’est à cette aberration qu’il faudra trouver rapidement un remède, sous peine de tomber dans les pires malheurs.
Chapitre 7
Je ne m'adresse qu'à ceux que l'existence du monde, incluant la leur propre, ne cesse d'émerveiller et de remplir d'une ferveur sacrée.
La seule existence d'un être quelconque est un miracle si prodigieux que sa contemplation pourrait occuper une vie entière. Mais la splendeur de l'univers, son ordre si parfait et si complexe qui peut néanmoins s'exprimer par quelques formules mathématiques simples, sa beauté infinie et la hauteur sublime où l'homme s'élève parfois par son intelligence, sa bonté et son amour doivent plonger tout homme sain dans un ravissement, dans une extase plus délicieuse que tous les plaisirs terrestres.
Cependant, l'être pour l'homme constitue d'abord un profond mystère que son intelligence apercevra toujours confusément pour l'essentiel, car l'extrême évidence de l'être cohabite dans son esprit avec l'impossibilité d'en saisir clairement l'origine, la cause et le sens. Et la science expérimentale, bien entendu, ne sera jamais que de peu d’utilité pour cet effet puisque ses méthodes mêmes la cantonnent dans l'observation des phénomènes matériels quantifiables, et qu'il serait vain de rechercher la cause de l'ensemble du monde par l'observation d'une de ses parties infimes. Sans compter que nos connaissances nous viennent en grande partie des sens, qui nous transmettent une image probablement déformée de la réalité, image qui n'existe d'ailleurs que dans notre esprit et non pas dans la réalité.
Ainsi le rouge que mon esprit perçoit est causé par l'action de la lumière d'une certaine fréquence sur mon œil; mais cette lumière en elle-même n'est pas rouge, pas plus que la surface qui la réfléchit et que je ne connais pas directement. Ce rouge n'a aucune existence dans le monde matériel : ce qui, soit dit en passant, prouve élégamment que l'esprit n'est pas réductible au matériel.
Mais si peu que l'on puisse soulever le voile du mystère qui nous empêche de comprendre clairement l'être, il faut le tenter et s'y appliquer de toutes nos forces. Pour ce faire, il faut d'abord faire confiance à notre esprit, à sa justesse, à sa capacité de connaître utilement, sanctionnée par le sentiment de l'évidence qu’il nous procure à l'occasion. Sinon, aucune lumière ne nous éclaire, l'évidence est une illusion, et l'intelligence prodigieuse dont l'humanité est douée, à tout le moins dans ses meilleurs éléments, ne mériterait aucune confiance, malgré les succès remarquables qu'elle a remportés dans tous les domaines.
Supposons donc qu'elle soit un guide assez sûr pour qu’on puisse s’y fier, en la contrôlant, bien entendu. Une des données essentielles de notre intelligence, c'est le principe de causalité, l'idée qu'un état de l'être s'explique et se comprend par un état « antérieur » de l'être. Antérieur dans l'ordre causal, et antérieur dans l'ordre temporel. Nous appliquons ce principe avec confiance dans le monde physique, à tout le moins à notre échelle, sans avoir été convaincus d'erreur, et il paraît donc naturel de l'appliquer globalement au monde lui-même, en postulant qu'il a, lui aussi, une cause qui l’explique et le fasse comprendre.
On pourrait d'abord penser, comme Spinoza, que l'être est sa propre cause, qu'il est Dieu, qu'il possède une infinité d'attributs parfaits, dont l'étendue, la pensée, et d'autres qui nous sont inconnus. Ou l'on peut suivre cette très longue et très vénérable tradition occidentale, qui affirme que le monde, malgré les perfections et les beautés qu'on y observe, est, aussi, frappé d’imperfection, à commencer par nous-mêmes, que les êtres qui le composent sont dans un flux perpétuel, par la désagrégation et la recomposition de leurs éléments, et que cette instabilité, cette imperfection, indiquent plutôt que le monde a été causé ou créé.
Cette cause ne nous est guère connue, sauf à dire que, pour bien expliquer l'univers, son immensité, sa splendeur, sa puissance et sa beauté, l'on doit supposer dans cette cause une puissance et une perfection sans limite imaginable. Cette perfection illimitée nous dispense d’ailleurs de poursuivre plus loin notre recherche, et nous permet de nous reposer dans la contemplation de cet Être non causé, parce qu’infini, illimité et parfait. Le nom de Dieu est généralement donné à cette cause depuis les penseurs grecs qui, les premiers, ont recherché Dieu par le seul effort de la raison, et montré qu’il pouvait être connu déjà par cette voie, indépendamment de toute foi religieuse.
Dans cette conception, que nous privilégions, Dieu, infiniment plus parfait que sa création, jouit d'une intelligence complète de tout l'être, d'une volonté toute puissante, et le monde, produit de cette volonté et de cette intelligence, résulte de desseins insondables, que seuls les grands mystiques pensent avoir entrevus parfois dans une fulguration et une extase indicibles. Bien qu'il soit aventureux de dire l'indicible, ce qu'on peut retenir de leur contemplation relève du mot «amour», d'un amour à côté duquel nos pauvres amours sont aussi petits et infirmes que nos plus belles créations comparées à la splendeur de Son œuvre.
Et nous qui marchons depuis si longtemps à tâtons dans l'univers incompréhensible où nous avons été jetés, pour notre bonheur et pour notre malheur, le terme de la connaissance de notre étrange destin que les meilleurs d’entre nous ont pu acquérir, c'est que nous y sommes placés, avec nos perfections et nos imperfections, par l'effet d'une cause d'une inimaginable puissance, dans un but obscur, souvent inquiétant, illuminé cependant pour de rares privilégiés par la fulguration intermittente d'un immense amour, qui se révèle assez rarement pour que la plupart des hommes l'ignorent, mais assez clairement aussi pour que plusieurs en aient une certitude absolue.
C'est dans cette pénombre, dans cet assemblage étrange de clair et d’obscur, que s'est déroulée la marche douloureuse et triomphante de l'humanité, animée tout juste d'assez d'espérance pour poursuivre sa quête et d'assez d'intelligence pour en deviner confusément la direction.
Chapitre 2
La connaissance et la science
L'empire incontesté qu’exerce la science sur l'humanité et le prestige presque exclusif qu'elle voudrait posséder reposent selon nous sur un malentendu qui doit être dissipé.
La science se définit par sa méthode, qui consiste dans l'observation humble et patiente des phénomènes matériels, mesurables et répétables, jusqu'à ce que des régularités d'abord, puis des lois s'en dégagent.
Ces lois ont toujours un statut essentiellement hypothétique et précaire, bien que le temps finisse par leur conférer une grande valeur, lorsque aucune observation, aucune expérience ne les infirment. Elles n'ont d'ailleurs de validité que si les observations ou les expériences qui les fondent sont incontestables, idéalement parce qu'elles sont vérifiables par une simple répétition.
Les résultats extraordinaires obtenus depuis quelques siècles par cette méthode en démontrent l’incomparable fécondité, certes, et les progrès matériels réalisés grâce à elle lui ont mérité une popularité et un respect considérables. Mais l'énorme valeur pratique de la science ne doit pas nous aveugler sur le fait qu'elle est condamnée par sa méthode même à n'appréhender du réel qu'un fragment très utile pour dominer la nature et en saisir le fonctionnement concret, mais qui ne nous renseigne pas, et ne peut nous renseigner, sur les vérités qu’il nous importerait le plus de connaître et qui portent sur la cause, le sens, la finalité de l'être, l'usage que nous devons faire de notre liberté.
Toutes ces questions, qui ne relèvent pas de l'observation des phénomènes matériels mesurables, dépassent totalement et dépasseront toujours ses capacités. Et il n'y aurait d'ailleurs évidemment pas grand mal à cela, puisqu'il est parfaitement normal que tout mode de connaissance ne nous renseigne que sur les objets qui sont proportionnés à ses méthodes. Mais le malheur, c'est que la science, par le discours de plusieurs de ses pontifes enivrés de ses succès, bien que dans un ordre très modeste, aspirent pour elle à un empire très étendu, en cherchant à éclaircir par ses méthodes les questions fondamentales qu’il importe vraiment à l'homme de résoudre.
Et les bienfaits dont la science a apparemment comblé l'humanité, la relative certitude de ses résultats fondamentaux ont fait regarder favorablement cette prétention par un grand nombre. C'est là une méprise regrettable, et aucun raisonnement n'est plus faux que celui qui rejette toute forme de connaissance qui n'est pas réductible à la méthode scientifique. Et l'idée, par exemple, qu'il faudrait conclure à l'inexistence de Dieu, ou de l'esprit, ou de toute autre réalité, parce qu'on n'en voit pas de preuve scientifique, est l'une des plus sottes qui puisse se former dans l'esprit humain.
Ses conséquences sont malheureuses, parce que l'objet de la science étant le monde matériel, ceux qui la pratiquent tendent à réduire le réel au matériel, envisagé comme une mécanique, ce qui favorise une représentation très pauvre de l'infinie complexité de l'être.
Donnons un exemple de ce dont il s'agit pour clarifier notre pensée. La présence de la vie sur terre, en nous et hors de nous, avec son inimaginable complexité et sa stupéfiante beauté, a toujours paru justifier l’évidence qu'un tel miracle ne pouvait être le fruit du hasard, et qu'il supposait un créateur intelligent qui a voulu et procuré ce résultat. Ceux que la pensée d'un être transcendant chagrine, et qui préfèrent l'idée d'un univers purement matériel, où aucun être supérieur ne vient entraver leur liberté ou diminuer leur prestige, prêchent que l'argument tiré de la complexité et de la splendeur des êtres vivants n'est pas valide, puisque la vie s'explique parfaitement, sans l'intervention d'aucune cause transcendante, par le banal mécanisme de l'évolution guidée par la sélection naturelle du plus apte à la survie.
Cependant, il est aisé de voir que cette explication simpliste n'a aucune valeur intellectuelle, pour un grand nombre de raisons.
D'abord, surtout maintenant qu'elle nous est mieux connue, la structure de l'univers physique nous emplit d'autant d'admiration et d'étonnement que la vie elle-même. Et pourtant, l'évolution n'explique en rien la complexité, la beauté, l'harmonie, la grandeur de l'univers matériel inanimé.
Ensuite, la vie n'a pu commencer et se développer jusqu'au degré de complexité où elle est parvenue que parce que l'univers inanimé la contenait en puissance, parce que sa composition et ses structures permettaient les phénomènes physiques et chimiques qui ont permis l'apparition et l'évolution de la vie. Mais qui ne voit aussitôt que le même argument finaliste, que nous tirons de la vie elle-même, peut être tiré de cet univers miraculeux, ainsi constitué qu'il contenait en puissance la vie telle que nous la connaissons. Et, encore une fois, l'explication par la sélection naturelle ne peut être évoquée à propos de l'état du monde avant l'apparition de la vie et rendre compte d’un monde doté de pareilles potentialités.
Également, parlant spécifiquement de l'être humain, l'idée qu'un mécanisme aussi lent que la sélection naturelle puisse expliquer, par la simple survie du plus apte et de rares mutations, l’apparition aléatoire de la quantité immense de systèmes incroyablement complexes qui nous composent, dans la période très limitée qui nous sépare de l'origine de la vie, relève d'une invraisemblable naïveté. Cette période ne peut raisonnablement aboutir, par hasard, à la formation de l'œil, du cerveau, de la pensée, de la reproduction, de la digestion, de la respiration et de tant d'autres systèmes dont la vie animale et végétale nous donnent le spectacle étonnant.
Pour passer du néant à nous, les organismes ont dû franchir des millions ou des milliards d'étapes par l'effet d'un mécanisme évolutif qui porte pour les animaux supérieurs sur une très longue durée, de l'ordre des millénaires et bien davantage. La durée disponible à l'action de l'évolution est clairement insuffisante, à supposer évidemment, contre toute vraisemblance, qu'une période de temps quelconque puisse expliquer notre apparition par ce mécanisme aveugle.
Enfin, l'évolution n'explique que les traits qui favorisent la survie de l'individu. Elle n'explique donc pas ceux qui sont indifférents à cette survie, encore moins ceux qui lui sont contraires. Pourquoi la beauté des fleurs, de tant d'autres formes vivantes dont les coloris, la texture, le galbe nous ravissent d'admiration ? Pourquoi les êtres vivants sont-ils programmés pour mourir ? En quoi cela les rend-il aptes à survivre ?
Sans oublier, pour conclure, le problème de la conscience pour laquelle la science n'a aucune explication matérialiste sérieuse et dont en particulier l'évolution d'organismes purement matériels ne peut aucunement rendre compte.
Non seulement la science par nature est-elle un mauvais guide dès que l'on agite des questions fondamentales, ce qui serait sans importance, mais elle cause un tort immense par l'esprit sectaire et souvent même fanatique de très nombreux scientifiques qui ne reconnaissent aucune valeur à toute connaissance que ne peuvent produire les ressources extrêmement limitées de l'étroite méthode suivie par la science expérimentale. A cause d'eux, la représentation que l'homme se fait du monde et de lui-même est plus pauvre, moins enrichissante et moins éclairante qu'elle ne pourrait l'être autrement.
Chapitre 3
L’homme
Le monde, tel qu'il nous apparaît du moins, ne compte qu’un seul être imparfait, et c'est l'homme lui-même.
L'univers matériel obéit avec une parfaite régularité aux lois qui le régissent, au niveau du moins où s'effectuent les observations de l'homme. Les animaux sauvages suivent leur instinct et les plantes leur nature qui en assure la conservation et la reproduction sans donner aucune prise au jugement moral.
L'homme seul possède le privilège de choisir, d'agir bien ou mal, de céder à l'attrait de sollicitations momentanément plaisantes bien que reconnues trompeuses ou défendues. De tous les objets de notre connaissance, le plus mystérieux c'est sans doute nous-mêmes.
C'est ici en particulier que la méthode scientifique se révèle totalement inadéquate et ne peut satisfaire cette curiosité insatiable qui nous pousse à chercher ardemment le secret de notre origine, de notre nature et de notre fin. Et cette connaissance incertaine, fragmentaire, doit être recueillie patiemment par chaque homme en méditant inlassablement sur les données que lui fournissent son expérience, ses intuitions et la lecture des grands textes qui illuminent la longue marche de l'humanité par des fulgurations exceptionnelles, qu'elles soient d'ordre philosophique, religieux ou même mystique. Et parmi ces illuminations, je retiens tout particulièrement celles qu'on peut tirer du récit de la création de l'homme dans la Genèse.
Selon ce mythe, peut-être le plus connu de tous les mythes, l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu est déchu de la félicité et de la perfection qui lui avait été réservées pour avoir mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Évidemment, l'homme rationnel est appelé à vivre une vie morale par ses plus profonds instincts, ce qui suppose qu'il doit être capable de découvrir ce qui est bien ou mal et d'en acquérir la connaissance. La faute ne peut donc pas être dans cet effort vers la connaissance du bien et du mal, mais plutôt dans le fait de s'y ériger juge souverain de ce qui est bien ou mal, indépendamment de toute recherche objective de ce qui s'impose comme moralement valable. Et c’est pourquoi la connaissance du bien est assimilée dans le récit biblique à un fruit qui charme les sens.
Autrement dit, la faute consiste à remplacer la recherche humble et patiente du bien moral fondée sur la contemplation de la nature du monde et de l'homme et sur leurs finalités, par une morale purement subjective, l'expression des désirs, des intérêts, des passions de chaque homme. C'est cette prétention à fonder en soi seul le jugement moral en toute indépendance que le texte de la Genèse condamne comme un délire d'orgueil par lequel l'homme veut s'égaler à Dieu en prétendant souverainement connaître les lois d'un monde et d'une nature, la sienne propre, qu'il n'a pas créés. Et la source féconde du malheur de l'homme est là, dans cette prétention démesurée à poser les règles de sa vie en consultant ses délires, ses ambitions, ses intérêts supposés, sans égard à la réalité et à ses lois objectives.
Et le malheur, c'est que le nombre de ceux qu’anime le désir profond et tenace d'approfondir sans cesse leur compréhension du monde et de toutes ses réalités est fort restreint, de sorte que la faute d'Adam est celle de l'immense majorité des humains dont l'intelligence est subordonnée à la survie et produit des notions, des raisons et même des raisonnements qui n'ont d'autre origine que le désir de justifier et de soutenir leurs appétits, leurs intérêts et la conception instinctive qu'ils se font de leur bien. Et le malheur se compose et s'augmente du fait que, peut-être inévitablement, la pensée du grand nombre est produite collectivement par imitation, répétition et émulation. Cette caractéristique, utile certes à l'éclosion d'une pensée capable de rallier ou d'inspirer à une action collective un peuple donné pendant une certaine période de son histoire, rend encore plus difficile la formation d'une pensée rationnelle, réfléchie, objective. Ces épithètes, si l'on y pense bien, décrivent assez mal l'excitation, la précipitation, l'irréflexion et l'outrance des phénomènes collectifs.
Chapitre 4
L’exemple du féminisme
Illustrons nos propos par quelques réflexions sur une idéologie qui a connu le plus grand succès depuis cent ans, le féminisme, et tâchons de montrer la part d'irrationalité et de fausseté qu'elle contient.
Je précise cependant que je ne soutiens pas la thèse que le féminisme comporterait plus d'irrationalité ou de fausseté que d'autres idéologies, car je crois au contraire que les conditions dans lesquelles s'élaborent toutes les formes de pensée collective les condamnent à l'erreur et à une égale irrationalité.
La première chose qui résulte de l’application concrète du féminisme, c'est une réduction considérable du taux de natalité des sociétés qui l'adoptent, bien en deçà des taux qui permettent la croissance ou même le maintien de la population en cause. Il en résulte, inexorablement, que pour éviter une décroissance accélérée de cette population, qui mène à la stagnation économique, conduit à imposer aux jeunes la charge d'entretenir une fraction toujours croissante de la population vieillissante, et qui ultimement produira l'extinction du peuple en cause, il devient indispensable d'admettre un flot considérable d'immigrés qui ne pourront provenir des sociétés qui partagent nos valeurs et notre culture, puisqu'elles ont aussi désespérément besoin d'attirer des immigrants, et pour les mêmes raisons que nous.
Ces flots migratoires devront donc nécessairement provenir de sociétés non-féministes, possédant un taux de natalité élevé, ce qui en pratique signifiera le plus souvent les sociétés issues de l'Islam ou de l'Afrique noire. Il pourrait donc bien arriver que le féminisme mène insensiblement à l'afflux croissant de populations non-féministes, au taux de natalité fort élevé, qui finiront par dominer la société, ou du moins y exercer assez d'influence pour combattre avec plus ou moins de succès le féminisme lui-même.
En somme, il était évident au départ que le féminisme risquait de se détruire lui-même à la longue, par la sévère dénatalité qui en résultait. Ce grave problème a-t-il reçu la moindre attention ? A-t-il suscité la moindre discussion ? Est-il même permis de le poser clairement ? Non, dans tous les cas, parce que le féminisme n'est pas une pensée, mais une construction collective où l'intelligence prend beaucoup moins de part que le désir ou l'intérêt.
De la même façon, si le féminisme relevait de la pensée et de la raison, il aurait consacré tous les efforts nécessaires pour élucider en toute sérénité et en toute objectivité les nombreux problèmes qu'il pose par essence. Par exemple, où sont les discussions objectives et sérieuses sur les conséquences de la dislocation complète de la famille, qui en était une conséquence naturelle et prévisible. Quel effet la disparition des familles stables a-t-elle sur les enfants ? Est-il vrai que les hommes et les femmes ont à peu près les mêmes aptitudes et peuvent embrasser avec un même succès et un même bonheur les mêmes carrières ? Dit autrement, les femmes trouvent-elles le même épanouissement que les hommes dans les carrières traditionnellement réservées à ceux-ci?
Ou encore, risquent-elles de les transformer profondément par leur manière différente de les exercer ? Et cette transformation est-elle avantageuse dans tous les cas?
On peut aussi se demander ce que deviendra dans ce bouleversement l'amour profond, total, entre l'homme et la femme, joyau infiniment précieux, source des plus grandes joies et meilleure chance de bonheur pour d'innombrables êtres humains. Il était inévitable que cet amour périclite entre l’homme et la femme devenus compétiteurs, parfois féroces, engagés dans un même mode de vie épuisant, et privés de cette harmonieuse complémentarité qui les rapprochait infiniment en les éloignant infiniment.
Sans compter la question fondamentale qui gît à la racine du féminisme et qui nous interpelle avec une inévitable brutalité :
Est-il possible que la femme ait été condamnée à réaliser parfaitement sa féminité en singeant avec plus ou moins de succès la masculinité?
Encore une fois, non seulement toutes ces questions ne reçoivent-elles aucune attention sérieuse, mais même une sorte d'anathème frappe tous ceux qui seraient assez intempestifs pour tenter de les soulever.
Prenons un seul exemple, celui de l'égalité des aptitudes entre les deux sexes, et surtout des aptitudes intellectuelles, plus difficiles à mesurer que la force physique, où la femme se console aisément de son infériorité, vu que depuis fort longtemps, ce n'est plus par son moyen qu'on va à la richesse, au pouvoir, aux honneurs.
Cette égalité ne peut sans crime être mise en doute, et pourtant, il crève les yeux qu'elle tient de la fantaisie et du mythe. Précisons que nous parlons surtout ici des meilleurs éléments des deux sexes, des individus les plus doués, les plus créateurs. Ceci dit, il est incontestable que dans le domaine de l'intelligence abstraite, les hommes sont la cause IMMÉDIATE (il faudra revenir sur ce point essentiel) de la quasi-totalité des découvertes de l'humanité depuis l'origine. La philosophie, les mathématiques, la physique théorique et les autres sciences fondamentales, l’informatique, les progrès de l'intelligence artificielle sont leur ouvrage.
Même dans le domaine plus humble des jeux abstraits, comme le sont les échecs sous toutes leurs formes ou le go, les femmes ne compétitionnent pas plus avec les hommes que dans les sports physiques.
Et l'on ne peut plus soutenir que cette disparité résulte des restrictions sociales qui empêchent l'épanouissement des femmes, puisque ces restrictions sont abolies depuis plusieurs générations.
En réalité, il n'y a que les domaines où l'État exerce une influence déterminante qui paraissent échapper à cette règle. Mais cette apparente égalité résulte du parti pris avoué de l'État d'avantager les femmes en leur garantissant un accès égal à tous les avantages qu’il peut conférer : nominations, récompenses, honneurs, subventions, crédits, etc.
Sitôt cependant que le départage des concurrents repose sur une base objective comme la victoire aux échecs ou la découverte de théorèmes difficiles, l'homme reprend tranquillement son avantage.
Je ne crains pas de dire que tout ceci est tellement évident qu'un jour nos descendants seront incapables de comprendre comment nous avons pu tomber dans cet excès de stupidité qui nous a empêché non seulement de le voir mais même de nous poser la question et d'accepter qu'on en discute. Il est inévitable cependant que ces mêmes descendants souffrent à leur tour de cécités partielles différentes mais d'une égale gravité, dont par aucun effort de leur volonté ils ne pourront se rendre conscients.
Chapitre 5
La démocratie
Aucune idée n'a si profondément modelé notre époque que l'idée démocratique, que nous devons maintenant essayer de mieux comprendre. La démocratie s'articule autour de deux pôles contradictoires. L'égalité d'une part, la liberté de l'autre.
Ils sont contradictoires parce que pour faire régner l'égalité entre des individus radicalement inégaux, l'État devra user d'une contrainte destructrice de la liberté. Si d'autre part, il protège la liberté et laisse ses sujets régler librement leurs affaires entre eux, les inégalités les plus choquantes en résulteront aussitôt.
Les démocraties naissantes ont avant tout cherché à créer les conditions de la liberté, plus faciles à établir parce qu'elles résultent de la passivité de l'État, toujours aisée à pratiquer. La seule forme d'égalité qui s'impose à l'origine, parce qu'elle touche à l'essence du régime, c'est l'égalité politique qui se réalise par la participation égale à l'élection des gouvernants. Non pas que les démocraties commencent par le suffrage universel, ils s'en faut de beaucoup, puisque dans leurs commencements, une grande majorité de la population est généralement exclue du vote.
Les fondateurs de la démocratie américaine, par exemple, auraient été horrifiés à l'idée qu'un jour les esclaves et les pauvres voteraient. Ils auraient même regardé avec suspicion la possiblité d’intéresser leurs femmes, qu’ils aimaient pourtant tendrement, à la chose publique. Sans doute auraient-ils préféré demeurer dans le giron de la monarchie britannique que de tomber un jour au pouvoir de cette multitude effrayante. Car la croyance constante de tous les penseurs du passé, c'est que l'immense majorité des hommes est incapable non seulement de participer directement au gouvernement de l'État, mais même d'exercer une influence bénéfique sur aucun aspect de la vie en société.
Cette pensée, par prudence, ne s'est pas toujours clairement exprimée, mais il est toujours aisé d'en percevoir la trace tout au long de l'histoire. Ce constat traditionnel repose sur un trait fondamental de la réflexion politique et morale de l'Occident, je veux dire un pessimisme radical sur les capacités intellectuelles et morales de la plupart des hommes. Et ce que les fondateurs de républiques envisageaient finalement comme égalité, se limitait à permettre à une partie de la population de se donner librement un gouvernement, en choisissant parmi plusieurs candidats, tous issus de l'élite politique de la société, et tous d'accord sur l'essentiel des valeurs et des attitudes qui assuraient la pérennité et la prospérité de cette société.
Et ce code d'honneur comportait comme pierre angulaire que les candidats au pouvoir politique allaient déterminer les éléments fondamentaux de leur programme d'action en leur âme et conscience, et sans céder à la tentation facile de déférer aux caprices populaires ou de flagorner leurs électeurs en se réglant entièrement sur leurs désirs, si déraisonnables soient-ils.
Cependant, les démocraties occidentales modernes ont été établies juste après la publication des écrits de l'un des écrivains les plus influents et les plus désaxés de l'histoire, Jean-Jacques Rousseau. Il a voulu en effet lever la condamnation qui pesait sur l'homme depuis l'origine de la pensée occidentale et dissiper le pessimisme radical qui en découlait, en réhabilitant pleinement l’homme, en proclamant que le spectacle tragique de ses erreurs et de ses folies avait jusqu'à lui été mal interprété, puisqu'en vérité ces défaillances bien réelles du caractère et des actions de l'homme ne résultaient pas de sa nature, qui était excellente, mais de la corruption de cette nature par l'action délétère de la société, seule responsable de la folie et des crimes de l'humanité.
Autrement dit, et pour la première fois, l'homme était invité à se disculper de ses fautes pour accéder à un statut supérieur en évoquant sa condition de victime : technique promise, comme on le sait, à un si brillant avenir.
Cette croyance insuffle une nouvelle vigueur au concept de l'égalité, puisque les inégalités observées ne sont plus que les différents degrés de corruption, par la société, d'individus à l'origine excellents et non responsables de leurs nombreux manquements.
Il faut dire aussi que dans le conflit déjà signalé entre la liberté et l'égalité, cette dernière, peu développée à l'origine, possède néanmoins un précieux avantage, puisque c'est elle qui constitue la marque essentielle de la démocratie. La liberté, en effet, peut se retrouver dans tous les régimes, et l'on pourrait même théoriquement concevoir une démocratie d’où elle serait absente, si tel était le voeu de la volonté générale.
Il était donc tout naturel que le ferment d'égalité que contenaient les démocraties occidentales à l'origine, et qui en constituait, à l’insu peut-être de ses fondateurs, le principe actif essentiel, développe ses potentialités toujours davantage au fil du temps, sous réserve peut-être de quelques épisodes historiques anormaux, comme le fascisme ou le nazisme, qui, malgré leur origine purement démocratique, dérogent temporairement au développement de l'idée d'égalité.
Il en est ainsi parce que toute société est fondée sur un équilibre conforme à ses principes fondateurs. Mais cet équilibre ne peut être statique, attendu qu'un groupe humain, comme tout être vivant, est dans un flux et un mouvement perpétuels, qui lui interdisent de demeurer identique à lui-même dans le temps. De sorte qu'il arrive que, pour conserver son identité, ce groupe doit rester fidèle à son principe, et que, pour évoluer, il n'a d'autre choix que de donner toujours plus d'extension à ce même principe. Malheureusement, cette extension ne peut croître indéfiniment sans tomber dans l'abus, dans l'excès, et sans compromettre fatalement, un jour, la survie du régime.
Et c'est exactement le chemin qu'ont parcouru, avec des nuances de détail, les démocraties occidentales. L'idée d'égalité, si restreinte à l'origine, n'a cessé de s'étendre pour englober les femmes, les hommes de toutes les races, les pauvres, toutes les personnes revendiquant avec succès le statut de victime historique à cause de n'importe quelle caractéristique personnelle, si ténue soit-elle. Ce statut, qui atteste d'une inégalité passée, ouvre le droit à la cessation immédiate de cette inégalité et, surtout, à des réparations fort intéressantes qui prennent toutes les formes imaginables, depuis l'argent jusqu'à une préférence avouée dans l'accès aux charges et aux honneurs dispensés par l'État, sans égard au mérite réel.
Une autre extension déplorable de la notion d'égalité concerne l'égalité politique. La conception de départ, suivant laquelle la majorité ne possédait pas les qualités intellectuelles et morales pour déterminer directement la politique appropriée à la conjoncture, mais pouvait choisir valablement entre les propositions rivales des divers partis, dirigés par l'élite de la société, a été abandonnée. En effet, les majorités actuelles, même et surtout quand elles se composent largement ou presque exclusivement des éléments les moins intelligents et les moins éduqués d'une société, s'attendent à ce que leurs chefs exécutent aveuglément les idées saugrenues ou dangereuses que leur pensée fruste et incompétente a engendrées. Bien entendu, cette évolution eut comme corollaire l'apparition d'une classe de démagogues sans honneur et sans scrupule, prêts à offrir à ces multitudes égarées les mirages ridicules de grandeur et de prospérité qui leur assurent le pouvoir, le seul objet de leur désir. L'une des conséquences les plus funestes de l'extension excessive de la notion d'égalité, c'est l'opprobre et l'infamie qui s'attachent à tout discours qui remet ce dogme en question, notamment en rappelant que la seule égalité possible entre des êtres humains est l'égalité de droit, qui porte sur la dignité et la valeur de ceux-ci, et non pas l'égalité de fait, qui porte sur les différentes aptitudes de l'âme et du corps, lesquelles varient à l'infini selon l'individu, le sexe, la race, l'origine sociale, la génétique, l'éducation, etc.
Toute remise en question de l'égalité de fait au détriment des groupes de prétendues victimes d'inégalités historiques est punie de mort sociale, empêchant par là tout examen un tant soit peu rationnel de la vérité de cet égalitarisme outrancier.
Et une conséquence de cette conséquence, c'est que le groupe humain à qui l'humanité doit IMMÉDIATEMENT (j’ai dit qu’il faudra revenir sur ce point essentiel) la presque totalité de son progrès et de ses richesses culturelles et matérielles, les hommes occidentaux et en particulier l’élite de ceux-ci, tendent à être regardé avec méfiance, si ce n'est même diabolisés. Ce point, atteint et même dépassé depuis un certain temps dans les démocraties avancées, établit clairement une perte de contact collective avec la réalité, une folie générale qui annonce la mort imminente de la société affectée. J'en donne un seul exemple, parmi des milliers d'autres possibles, mais je crois qu'il est important de le méditer. L'un des innombrables effets pervers d'un féminisme affolé, c'est l'obsession presque exclusive de plusieurs avec le problème des agressions sexuelles, même sans gravité. Pour ces gens, l'État devrait mettre cette question au sommet de sa liste de priorité, comme s'il n'y avait pas mille problèmes plus importants et plus urgents que celui-là, surtout que les tribunaux existent depuis longtemps pour en fournir une solution acceptable. Mais comme plusieurs accusés avaient été acquittés en raison du fait que la plaignante leur avait exprimé sa satisfaction ou son affection ou sa bienveillance après la prétendue agression, et comme tout acquittement en cette matière est scandaleux, certains législateurs ont adopté des lois susceptibles d’être interprétées comme interdisant de tirer des inférences défavorables à la plaignante à partir de ces marques postérieures d'affection ou d'appréciation, au motif que ces inférences perpétueraient des stéréotypes répréhensibles. Il serait absolument incroyable de voir qualifier de stéréotypes blâmables le simple fait que la femme est un être rationnel et que l'on peut croire qu'elle aime ou qu'elle apprécie quand elle le dit, qu'elle l'écrit ou qu’elle agit de manière à le laisser supposer. Il est absolument évident qu'une société qui serait prête à donner valeur législative à une aussi injuste stupidité mériterait la mort prochaine qui l'attendrait certainement.
Chapitre 6
La crise actuelle
L'emprise qu’exerçait sur la société l'idéologie égalitaire, qui dans son long développement avait incorporé le féminisme et tous les mouvements recherchant la réhabilitation des victimes d'inégalités historiques était si forte, elle semblait si incontestable, et l'énorme pression psychologique et sociale qu'elle faisait peser sur ses opposants semblait si prépondérante, qu'il était devenu difficile d'imaginer que le mouvement n'irait pas sans cesse de l’avant, en développant sans fin de nouvelles conséquences qui nous plongeraient inévitablement dans toujours davantage de mensonge, de faiblesse, de bêtise et d’insignifiance.
Ce que nous avons appelé l'équilibre dynamique des démocraties occidentales, fondé sur l'accroissement indéfini des potentialités du concept d'égalité, était parvenu à un point critique où l'ordre social n'était plus que le reflet sans valeur et sans vérité des pensées et des aspirations de l'homme vulgaire, de celui qui se nourrit joyeusement des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et qui remplace la recherche difficile de la vérité et l'exercice pénible de la raison par l'affirmation péremptoire de la valeur de ses désirs, de ses intérêts et de ses préjugés. Et les peuples firent l'apprentissage de la tyrannie la plus déprimante, celle de la bêtise, contre laquelle, selon le poète Schiller, les dieux eux-mêmes luttent en vain.
Pourquoi l'inférieur ne commanderait-il pas, puisqu'il est l'égal du supérieur ?
Nous avons vu cependant, non sans surprise, cette construction artificielle, irrationnelle et fausse, s’effondrer subitement sous nos yeux dans un fracas retentissant.
Les événements qui transforment le monde et les États-Unis, et qui ont culminé par l'élection du dernier président, ont opéré un changement radical dans les préoccupations et la mentalité de nos sociétés, qu'il nous faut maintenant examiner.
Observons d'abord que l'accès au pouvoir de cet homme n'a été rendu possible que par la désertion massive des élites politiques traditionnelles, rebutées sans doute par la dégradation constante des conditions d'exercice de la profession politique, de plus en plus marquée par la bêtise, la bassesse, la grossièreté et l'abaissement du niveau moral et intellectuel du débat politique, qui est maintenant devenu celui de l'homme moyen, ou de quelque chose de pire encore.
La meilleure preuve en est que le peuple le plus puissant de la planète, d'une population de 350 millions d'individus, n'a pu mettre en lice pour la direction suprême de l'État qu'un sous-homme totalement méprisable, et une femme bien intentionnée peut-être, mais à peu près dénuée de compétence, d'expérience et même d'intelligence.
Peut-être que le mouvement égalitaire américain a péri par l'effet de ses propres principes, en croyant bêtement qu'une candidate qui réunissait les qualités de femme et de noire ne pouvait manquer d'emporter la victoire.
Disons ensuite qu'il peut sembler, à première vue, que la victoire de l'actuel président emporte la fin d'une idéologie égalitaire et victimaire fausse et débilitante, et qu'elle annonce une réaction aussi salutaire qu'inattendue contre cette forme dégénérée du principe d'égalité qui inspirait le parti politique adverse.
Ce serait une grave erreur et il est essentiel de constater et de dire hautement que la victoire de l'actuel président, dont les discours sont tout sauf égalitaires, est néanmoins due précisément à la même dérive de l'esprit démocratique, puisque l'adhésion d'une majorité d'électeurs à un personnage aussi répugnant à tous égards et à une doctrine aussi stupide ne peut être le fait que d'un groupe dénué à la fois du pouvoir de penser par lui-même et de l'humilité et du bon sens de se contenter d'arbitrer entre deux candidats valables et dignes, qui exposent honnêtement et rationnellement leurs conceptions personnelles du bien public.
En fait, nos démocraties ne peuvent plus corriger leur vice par l'heureux succès d'un scrutin, puisque maintenant le succès de ce scrutin est par définition le fait d'un groupe incapable de penser rationnellement par lui-même ni de choisir entre ceux qui le peuvent.
C'est pourquoi tous ceux qui à bon droit souffraient des effets délétères de l'égalitarisme excessif qui ravageait la société ne doivent aucunement se réjouir du triomphe de la droite américaine qui a mis un terme à ces abus. Il est impératif qu'ils réalisent au plus tôt qu'il s'agit simplement d'un changement d'erreur, que les folies nouvelles sont aussi destructrices que les anciennes, sinon davantage, et qu'une pensée informe, irréaliste et sans noblesse, comme le sera toujours la pensée collective de l'homme déchu, ne peut mener qu'à l'échec, quelles que soient les formes opposées qu'elle pourra revêtir.
Un examen sommaire des grands traits de cette doctrine et de ceux qui la soutiennent nous aura vite convaincus de sa complète nullité.
D'abord, elle est exposée et défendue par de vrais barbares, ce qui sans plus la déconsidère.
Le président, ses ministres et ses acolytes forment une bande de demi-civilisés, sans culture, sans humanité, sans raffinement, sans intelligence véritable et profonde. En un mot, ce sont des nains intellectuels et moraux.
Ensuite, leur univers mental primitif tourne autour des concepts grossiers de pouvoir, de force, d'argent, de finance, d'armée, de technologie, de production, de taxe, d'économie. Ce sont probablement les êtres humains les plus nuls et les moins bien réussis qui aient jamais occupé l'attention du public depuis l'origine.
Et leur terrifiante bêtise va probablement jusqu'à croire que le secret du bonheur pour l'homme réside dans l'argent corrupteur, le pouvoir destructeur et une technologie délirante affranchie de toute morale et de toute réflexion. En un mot comme en cent, ce sont tous de purs minables. Ils sont l'incarnation contemporaine de ce vil Calliclès qui, dans le Gorgias de Platon, embrasse la thèse que la justice, au fond, n’est autre chose que la force.
Et je crois fermement que leur bassesse foncière s’explique essentiellement par leur radicale séparation de toute influence féminine véritable et profonde. Je disais tout à l’heure que l’homme, grâce à ses dons intellectuels remarquables, est la cause IMMÉDIATE de la plupart des manifestations de la merveilleuse faculté de connaître impartie à l’humanité par Dieu. Mais l’exercice de ces mêmes facultés intellectuelles peut aussi bien le faire tomber dans la folie délirante des mégalomanes actuels, ivres de technique et de puissance et foncièrement nuisibles aux sociétés qui les hébergent, que l’élever aux plus sublimes vérités sur ses fins dernières ou sur le Beau.
Et l’influence qu’exerce la femme dans la société sera déterminante à cet égard. C’est elle qui par ses vertus spécifiques et ses dons essentiels élèvera ou abaissera le regard de l’homme, et donnera plus ou moins de hauteur et de valeur à sa pensée. Et ce n’est pas un hasard si la dégradation du climat politique et intellectuel est la plus grande aux États-Unis, cette société profondément inférieure sur le plan moral, frappée dès sa naissance d’un vice radical, la « Auri sacra fames », cette soif maudite de l’or, cette avidité de possessions matérielles et de puissance, qui est l’héritage empoisonné légué au monde par l’esprit anglo-saxon, incarné tout particulièrement dans la mentalité américaine, où même la religion devient pour plusieurs une entreprise commerciale sans dogme, sans traditions et sans beauté.
C’est là, plus que partout ailleurs, que les femmes achèvent de perdre jusqu’à la dernière trace de ces dons et de ces traits merveilleux qui en faisaient, à tellement d’égards, les guides, les inspiratrices et les éducatrices indispensables de l’homme, qui sans elles ne peut plus jouer que le rôle d’une brute sans grâce et sans finesse.
Cela dit, il est absolument essentiel de réaliser que les propos et les actions de ces hommes, si révoltants et si horribles qu'ils soient, n'ont qu'une importance très secondaire et ne devraient pas nous occuper outre mesure. Après tout, leur existence prouve seulement que l'espèce humaine comporte des tarés sans honneur, ce qui n'est pas bien nouveau. La seule question intéressante que pose leur existence n'est pas de savoir pourquoi ils sont, mais pourquoi ils ont été choisis avec enthousiasme et conviction par une importante majorité d'électeurs. C'est sur ce point seulement que devront se porter toutes nos réflexions, parce que c’est à cette aberration qu’il faudra trouver rapidement un remède, sous peine de tomber dans les pires malheurs.
Chapitre 7
La suite
Est-il possible de hasarder maintenant des prédictions sur l'avenir politique qui s'offre à l'humanité ? Rappelons d'abord que celle-ci, a traversé quantités de crises, dont plusieurs épouvantables, sans jamais périr.
Tout au plus a-t-elle dû payer par ses souffrances les erreurs où l'avait jetée sa bêtise.
Peut-être faut-il en chercher la raison dans ce que nous avons discuté en premier lieu, touchant à ce que le monde est le produit d'une cause intelligente, sans doute bienveillante, poursuivant une fin définie qui, même si elle nous échappe, chemine inévitablement vers son terme. Il est donc probable, selon nous, que le régime démocratique actuel sera remplacé, après des péripéties plus ou moins difficiles et plus ou moins longues, par un régime fonctionnel, et qu’il se sera débarrassé de ce qui l'empêche maintenant de réaliser le bien commun.
C'est-à-dire que, d'une manière qui échappe à toute description précise, la partie obscure des peuples ne sera plus admise à exercer sur la politique et sur la société en général l'influence directe et déterminante qui lui est maintenant réservée. Que cela semble maintenant, pour plusieurs, impossible ou impensable n'a aucune espèce d'importance. Après tout, tous les grands changements de l'histoire ont paru à la plupart des hommes impossibles ou impensables, souvent même au moment où ils se produisaient.
La méfiance justifiée qui entoure les « élites » actuelles tombera, quand se seront reconstituées d’authentiques élites, nourries d’humanités, conscientes des traditions les plus hautes de l’Occident, inspirées d’un idéal noble et digne d’admiration, soucieuses du bien véritable de tous, convenablement détachées des faux biens grossiers que sont le pouvoir et l’argent.
Et le temps sans doute viendra bientôt où le cri de ralliement de ceux qui offriront aux peuples épuisés le seul espoir de salut sera:
« Aristocrates du monde entier, unissez-vous! »
La suite
Est-il possible de hasarder maintenant des prédictions sur l'avenir politique qui s'offre à l'humanité ? Rappelons d'abord que celle-ci, a traversé quantités de crises, dont plusieurs épouvantables, sans jamais périr.
Tout au plus a-t-elle dû payer par ses souffrances les erreurs où l'avait jetée sa bêtise.
Peut-être faut-il en chercher la raison dans ce que nous avons discuté en premier lieu, touchant à ce que le monde est le produit d'une cause intelligente, sans doute bienveillante, poursuivant une fin définie qui, même si elle nous échappe, chemine inévitablement vers son terme. Il est donc probable, selon nous, que le régime démocratique actuel sera remplacé, après des péripéties plus ou moins difficiles et plus ou moins longues, par un régime fonctionnel, et qu’il se sera débarrassé de ce qui l'empêche maintenant de réaliser le bien commun.
C'est-à-dire que, d'une manière qui échappe à toute description précise, la partie obscure des peuples ne sera plus admise à exercer sur la politique et sur la société en général l'influence directe et déterminante qui lui est maintenant réservée. Que cela semble maintenant, pour plusieurs, impossible ou impensable n'a aucune espèce d'importance. Après tout, tous les grands changements de l'histoire ont paru à la plupart des hommes impossibles ou impensables, souvent même au moment où ils se produisaient.
La méfiance justifiée qui entoure les « élites » actuelles tombera, quand se seront reconstituées d’authentiques élites, nourries d’humanités, conscientes des traditions les plus hautes de l’Occident, inspirées d’un idéal noble et digne d’admiration, soucieuses du bien véritable de tous, convenablement détachées des faux biens grossiers que sont le pouvoir et l’argent.
Et le temps sans doute viendra bientôt où le cri de ralliement de ceux qui offriront aux peuples épuisés le seul espoir de salut sera:
Aristocrates du monde entier, unissez-vous! »